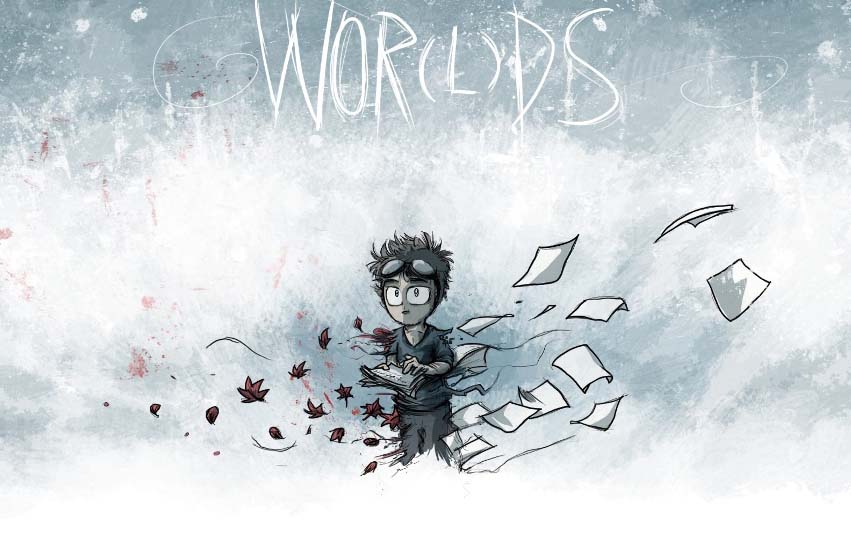Lorsque le Vieillard se réveille, il est à terre, adossé à une colonne. Un temple l’entoure, qui abrite d’interminables colonnades, toutes identiques, et qui se prolongent, encore et encore, à perte de vue.
Le Vieillard se lève. Ses jointures craquent un peu, sa démarche est hésitante, mais un pas après l’autre, il se met en route vers la sortie. A droite comme à gauche, devant et derrière, le même décor se répète à l’infini, et chaque pas dévoile un nouveau pilier, identique au précédent. Il cherche une sortie, et marche pendant des heures sans jamais la trouver.
De temps à autre, le Vieillard croise d’autres gens, qui comme lui, errent comme des ombres dans le temple. Certains vont dans d’autres directions, et le croisent sans s’arrêter.
Alors il leur dit :
- Ce n’est pas par là qu’il faut aller.
Mais personne ne fait jamais attention, et le Vieillard a beau leur expliquer, les supplier de l’écouter, les autres haussent les épaules, et sans un mot, reprennent leur route. Ceux qu’il croise ne restent jamais, et finissent inévitablement par disparaître dans l’ombre des colonnades. Quand il reprend la route, il est toujours seul.
Le Vieillard s’écroule enfin, mais ce n’est pas la fatigue qui le terrasse, car il n’a pas faim, ni soif, ni sommeil. C’est la lassitude, et elle seule qui l’oblige à s’arrêter, et à genoux, il cherche le courage de reprendre sa route.
Une ombre l’effleure, c’est une femme en blanc. Elle pose sa main sur son épaule, et, s’approche par derrière, murmurant à son oreille.
- Il est si facile d’arrêter, pourtant...
- Je ne veux pas arrêter, répond le vieillard, je veux sortir d’ici.
Il y a du désespoir dans ces mots.
- Il n’y a pas d’autre sortie, dit la voix.
Lorsqu’il se retourne, elle a disparu. Il sent un poids à sa gauche, une dague en argent est glissée à sa ceinture. Il contemple l’objet avec hésitation, le remet à sa place. Le Vieillard ne veut pas arrêter, il veut simplement sortir d’ici, sans trop savoir pourtant si quelqu’un l’attend dehors, sans même être sûr que dehors existe.
Le vieillard avance. Il se dirige peut-être vers un but, peut-être vers le néant, mais peu lui importe. S’il y a un but, alors il s’en rapproche.