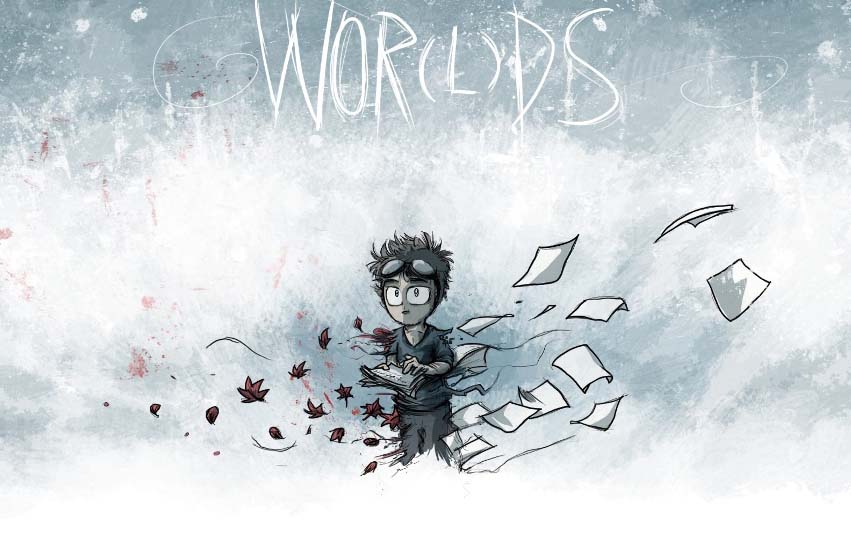Je mets quelques secondes à comprendre ce qui m’arrive.
Je suis en train de traverser un porche richement décoré, rue du Faubourg Saint-Honoré. Un chasseur m’ouvre la porte, et me dévisage, au vol, d’un regard, mi-snob, mi curieux. J’imagine que si je passais la tête haute, avec assez d’assurance, il ne me dirait rien. Mais voilà, je n’ai aucune idée de ce que je fous là, je porte mon habituel jean délavé et mon grand manteau aux poches trouées, et qui sèment sur mon passage une traînée de cartes de visite, de tickets de caisse et de menue monnaie entassée là depuis la nuit des temps.
- Je… Je suis invité à déjeuner par mes parents, dis-je, intimidé.
Et par ce que je me sens obligé de me justifier, j’ajoute :
- Ils sont déjà arrivés.
Pour appuyer mon propos, je pointe du doigt, dans la cour, une minuscule Citroën biscornue, couleur orange fluo, et qui détonne fermement au milieu d’un océan de de berlines à l’arrogance présidentielle, et à côté desquelles patientent des armées de chauffeurs au garde-à-vous.
Le chasseur me laisse passer. Je traverse les couloirs avec une assurance retrouvée, et avise, au fond de la salle, ma mère qui me fait un grand signe du bras pour m’inviter à les rejoindre. J’ai à peine le temps de laisser mon manteau à une serveuse qu’on me tire une chaise et que ma mère demande :
- On se prend une coupe de champagne ?
Mon père opine du chef avec un enthousiasme non dissimulé. Pour ma part, j’ai encore la gueule de bois de ma soirée de la veille – nous sommes un dimanche, il est midi, et à cette heure, j’ai pour habitude d’émerger péniblement et d’engloutir, en guise de petit-déjeuner, un épais cachet d’aspirine, dans l’espoir naïf, mais toujours renouvelé, que ma gueule de bois dominicale sera moins pénible que la précédente. Malgré cela, j’accepte la coupe de champagne, et de bonne grâce.
Les trois coupes arrivent. Je connais bien l’adage selon lequel le meilleur remède contre les lendemains difficiles est de continuer à boire – je n’ai simplement jamais pu m’y résoudre. En l’occurrence, quelques gorgées plus tard, l’alcool fait ses merveilles, mon mal de tête, bien que toujours présent, est relégué quelque part en arrière-plan et la conversation va bon train.
La coupe terminée, mon père passe de longues minutes à inspecter la carte des vins, les sourcils froncés, puis, d’un signe au serveur, lui désigne une bouteille sur la carte. Nous nous rendons au buffet pour remplir nos assiettes, et je profite de l’occasion pour me gaver d’œufs brouillés, de tranches de saumon sauceGravlax, de terrine au foie gras, de souris d’agneau, mais surtout d’œufs brouillés – par ce que j’adore ça, que le buffet est à volonté et par ce que j’ai l’appétit d’un ogre.
On parle de tout. De mes études qui touchent à leur fin, de ma petite amie, de mes projets, de leur maison qui sera un jour finie, des dernières expos, de notre famille, des événements récents. Mon stage de fin d’études touche à sa fin, et j’ai passé les dernières semaines à boucler des projets en retard – je n’ai fini que le vendredi soir, à une heure avancée de la nuit, et j’ai dû travailler pour des rapports destinés à ma faculté dans la journée du samedi. Dès que dix-neuf heures ont sonné, j’ai appelé mes amis à la rescousse, et nous avons passé l’essentiel de la nuit à nous saouler avec application.
La bouteille arrive, promptement débouchée puis goûtée par le paternel qui hoche la tête pour marquer son assentiment, suivi d’un des élégants euphémismes dont il est coutumier.
- Ça me va.
Eux, ils reviennent d’une semaine dans leur maison de vacances. Leur programme est quelque peu différent du mien mais il n’en est pas moins rigoureux. Les journées commencent au marché, à six heures du matin, suivi d’un petit déjeuner, d’un footing, d’une occasionnelle partie de golf qui s’étend jusqu’à une heure avancée de la journée. Le reste du temps, mes parents le dédient à la lecture, à la piscine, au café, à l’apéro.
Ils sont rentrés en voiture de vacances avec l’une de leurs deux voitures. Le retour est marqué par un contretemps. Une Golf GTI grise, en instance de dépassement, qui, échouant à se ranger assez vite sur la voie centrale, perd contrôle, et, dans un tête-à-queue quelque peu chaotique, heurte successivement la rambarde intérieure, la voiture de mes parents, et un panneau de limitation de vitesse qui n’avait rien demandé à personne. Un peu sonnés, les occupants des deux véhicules sortent de la voiturent, établissent les dégâts et constatent avec soulagement que personne n’est blessé. Les voitures, elles, vont moins bien – l’aile avant, à gauche de la voiture de mes parents s’est froissée en absorbant le heurt, brisant au passage l’un des phares, et laissant par l’occasion fuir une vilaine traînée noirâtre qui vient s’écouler jusque dans le bas-côté.
La Golf, elle, s’est enfoncée dans le bloc de béton qui supporte le panneau de signalisation. Le châssis de la voiture et sa carrosserie semblent avoir voulu prendre deux chemins divergents, puisque la carrosserie s’est tordue vers le haut, comme pour regarder le ciel, alors que le châssis semble avoir préféré s’enfoncer dans le sol, dans une étrange démonstration de schizophrénie automobile.
Ma mère me raconte l’histoire sur un ton badin, sans conséquence. L’assurance leur payant la prise en charge de la voiture, eux ont préféré sauter dans le premier train rentrant à Paris et laisser à quelqu’un d’autre le soin de s’occuper de la voiture. Et moi, au restaurant, j’écoute, les bras ballants, l’histoire qui vient de leur arriver.
C’est à ce moment, dans le train du retour, qu’ils décident de m’appeler m’inviter au restaurant, me disent-ils. L’accident a condamné la voiture à un aller simple à la casse. Mes parents, eux, vont bien.
C’est à ce moment, entre la poire et le fromage, que je comprends pourquoi je déjeune avec eux ce jour-là. Je comprends pourquoi je suis là, avec une bouteille de vin, des œufs brouillés, une coupe de champagne et un chasseur snobinard pour me tenir la porte à l’entrée.
La coupe de champagne, ce dimanche à midi, célèbre le simple fait d’être en vie.